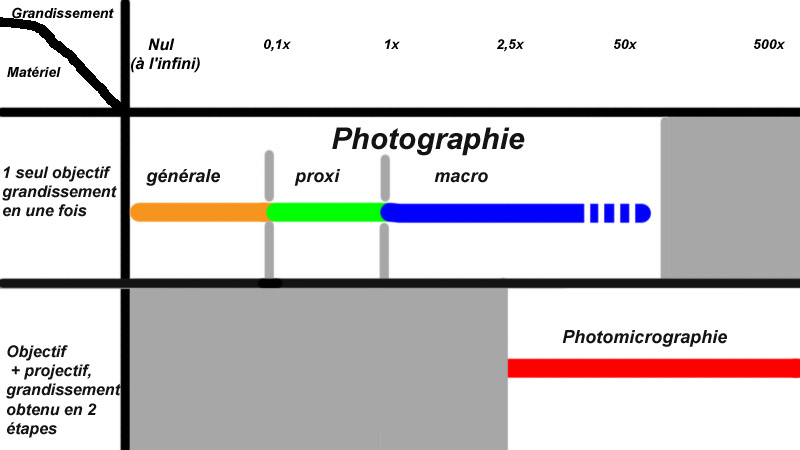 |
Cette question a fait couler beaucoup
d'encre et on constate que des conceptions différentes
existent actuellement, suite à la dérive du sens
d'origine.
A- définition
classique :
Traditionnellement, la macrophotographie
désigne les images de grandissement supérieur
à 1 (C'est à dire les images pour lesquelles
l'objet est
plus grand sur le film ou le capteur qu'il n'est en
réalité. ) et réalisées
avec une seule
optique grossissante. Il n'y a pas de limite supérieure
fixée, mais en pratique, il est difficile de
dépasser 50x.
Dans ce cadre, la
photo rapprochée ou proxiphotographie
correspond aux images photographiques entre
les portraits et la macro,
i.e.pour 0,1<Grandissement<1
La photomicrographie
est la prise de vues avec
un microscope composé qui comprend 2 optiques qui
participent chacunes au grandissement: objectif et projectif.
La gamme de grandissements va de 2,5x à 500 x (d'un objectif
1x
associé à un projectif 2,5x , jusqu'à
un objectif
100x associé à un projectif 5x).
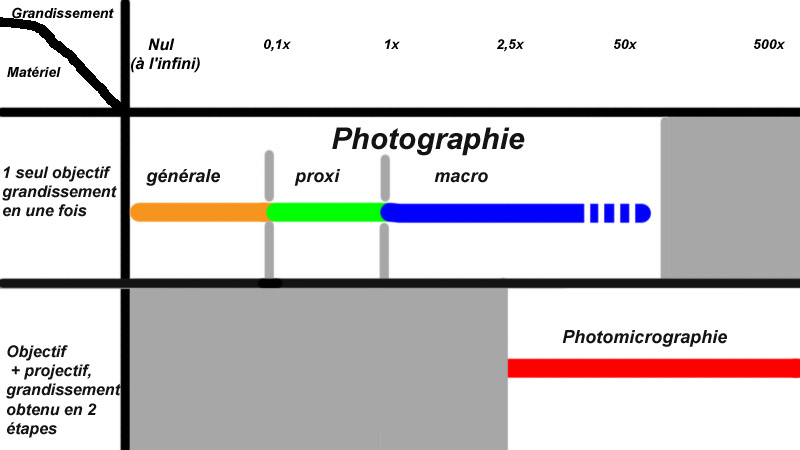 |
Un problème apparait sur cette figure: la macrophotographie et la photomicrographie partagent une partie de la gamme de grandissements, de 2,5x à 50x comme le montrent ces images réalisées avec les 2 techniques au mème grandissement approximatif
 macrophotographie de terrain au grandissement 3x avec l'objectif Canon MPE65 et l'éclairage d'un flasch latéral à gauche (éclairage épiscopique) |
 photomicrographie du mème sujet au microscope composé à 2,5x (microscope Olympus BHS, objectif 1x; projectif 2,5x) et éclairage par transparence (éclairage diascopique ) |
Ces 2 images se distinguent
facilement par le mode d'éclairage.La vue macro est
éclairée par dessus alors que la vue micro est
éclairée par transparence. En effet, le
microscope est souvent utilisé en diascopie (c’est
le cas en
biologie) mais il y a des appareils aussi pour
l’épiscopie (microscopes
métallographiques) . La macro des
photographes est généralement en
épiscopie, mais il est possible de réaliser des
images macro en
diascopie avec du matériel adapté...
Des précisions sont donc nécessaires, d'autant
que le mot macrophotographie a vu son sens dériver par
rapport à ce sens classique.
B- Evolution de la
définition de la macrophoto et problème de la
référence au capteur
1) Si dans les années 50, le terme de macro correspondait
bien
à un grandissement supérieur à 1, il a
été très galvaudé par les
pratiquants, déja à la fin de l'ère de
l'argentique. En fait il désigne actuellement le plus
souvent dans les
textes pour le grand public la proxiphotographie ...
Il faut avouer que ce sont surtout les scientifiques, les naturalistes
en particulier qui pratiquent cette vraie macro. Les sujets commes les
fleurs abordés le plus souvent par le grand public sont de
plus grande taille et nécessitent moins de
matériel spécifique.
On retrouve cette
évolution dans les livres consacrés au sujet:
j'ai comparé les définitions retenues par
différents auteurs à partir de la biblio que j'ai
mise en ligne il y a quelques temps à
cette adresse:
Les premiers, Pizon
(1949) et Perelli(1964)
suivent la définition classique, macrophotographie =
enregistrement photographique sous un rapport d'agrandssement
égal ou supérieur à un. Ils incluent
dans leurs livres la photomicrographie définie comme
l'enregistrement photographique obtenu avec le microscope
composé. Pour eux, "les deux techniques diffèrent
entre elles par le système optique adopté" .
c'est mon premier schéma, la vision "classique".
Pilorgé
(1972) utilise le terme "photomacrographie" et, après avoir
rappelé les débats déja
présents à l'époque, fixe ses limites
par les tailles de sujets allant de 240x360mm à 6x9mm, donc
par les rapports de 0,1x à 4x
Durand
(1982) entérine cet élargissement du domaine
macro. Il définit bien proxiphotographie de 0,1x
à 1x de la macrophotographie au dela de 1x et la
"microphotographie" (SIC) qui fait intervenir le microscope. Mais alors
que le préfixe MACRO est en rouge sur sa couverture, il
écrit "nous traiterons de la photomacrographie, mais
également de la proxiphotographie qui en est
inséparable".
Cogne (1986)
a la mème vision de la macro étendue à
la photographie rapprochée car il fait bien remarquer
"aujourd'hui, les fabriquant n'hésitent plus à
qualifier de macro des objectifs qui ne dépassent pas le
rapport 1:5"
Après cet élargissement du domaine dans les
années 70-80, Martin
et Loaec (2002) ne se donnent pas la peine d'un
définition précise de la macro "Tout sujet de
petite taille entre dans sa définition". ils citent
mème "batraciens, lézards et autre serpents"
comme des sujets macro! Mais ils soulignent aussi l'extraordinaire
évolution technique du matériel photo en fin de
XXe siècle et ils vont aussi dans leur livre du
coté des forts rapports en abordant la microphotographie au
microscope optique et mème au MEB! ils ont toutefois
borné la macro en introduction "s'étend
jusqu'à des facteurs de grandissement" ... "de l'ordre de 20
ou 30 fois..."
Dans le dernier titre en date, Wurmser
(2009) ne s'embarasse pas de technique "la macrophotographie est une
discipline de la photographie consistant à montrer en grand
des sujets qui ne le sont pas à la base"
A noter en complément, les auteurs du dictionnaire larousse
en ligne (consultation aout 2014) ne sont pas très
inspirés, ni très précis dans leurs
définitions:
photomacrographie
"photographie d'un très petit sujet effectuée
à une échelle voisine,
légèrement inférieure ou
supérieure à l'unité de grandissement"
Tout est dans le "lègèrement". A prendre pour un
facteur 5 ou 10?
Selon une norme DIN dont je n'ai pu retrouver la
date de création, ni si elle était encore en
valeur, la
"makrofotografie" s'étendrait entre les rapports
1:10 et
10:1 . En commençant à 0,1x, cela suit
l'extension de la
macro à la proxiphotographie au sens des années
1950.
Enfin j'ai
consulté les définitions
données dans le livre le plus récent
sur la macro du paléontologue
italien Enrico Savazzi "Digital photography for science" (2011) dont
le sous titre est:"close-up photography, macrophotography and
photomacrography"
il définit donc 3 catégories qui correspondent
à autant de chapitres de présentation de
matériel:
- le close up de 1:20 à 1:2 donc proche de la proxi
-
la macrophotography de 1:2 à 1:1, domaine des objectifs
macro de type
micro nikkor de 60, 105 et 200mm qui s'utilisent aussi facilement qu'un
objectif classique
- et la photomacrography de 1:1 à 30 ou 40:1, domaine plus
technique pratiqué en labo.A retenir donc dans les usages
actuels, le terme "macro" englobe la proxiphotographie .
|
|
2) Une difficulté
de la
définition classique est son lien via la notion de
grandissement à un format de
film, le fameux 24x36mm. Or cette référence s'est
fortement estompée. A l'ère du
numérique,
les capteurs sont de taille variable et mème si le format
24x36 est revenu pour permettre aux utilisateurs de
péréniser un parc d'objectifs anciens, ils sont
le plus souvent
maintenant très petits. Par ailleurs,
l’observation des photos ne se fait plus
exclusivement sur
papier , mais souvent sur écran et ces supports peuvent
avoir
une taille très variable de quelques cm pour un smartphone
à 1m voire plus pour un téléviseur. Il
faut donc
tenir compte de l’agrandissement
entre le sujet et le support d’affichage dans la
définition...
Pour cela le plus simple est de partir du champ photographié
pour définitir la macro. Et il faut s'affranchir de
la
distinction liée au type d'outils puisque les
différentes catégories d'outils permettent des
images comparables.
C-
définitions
retenues pour ce
travail
A
partir des anciennes
références en 24x36, on
peut se fixer une taille de sujet
photographié sur le premier plan net de l'image ou sur le
plan "principal" en cas de multifocalisation.
Il n'y a pas de difficulté pour le domaine de la proxi dont
les sujets vont donc de
36cm à 36mm de largeur.
La macro au sens strict commence donc avec des sujets de 36mm de
largeur.
Elle n'a pas de limite opposée définie.
Car ou commence vraiment le domaine correspondant à
l’usage d’un microscope
composé ?! Il existe des optiques de microscope 1x
pour observer au microscope un champ à
partir de 18mm de diamètre, mais l'objectif faible courant
est un 4x un champ observé ou photographié de
l'ordre de 4mm .
Toutefois, l'évolution de la pratique montre des images en
épiscopie avec des champs réduits à un
milimètre.
On peut donc
proposer comme limite le rapport de grandissement 36x
donc un champ de 1mm.
La macrophotographie
au sens strict correspond
donc à des sujets de 36mm
à 1mm
Le
champ de 1cm qui correspond
à peu près au maximum de grandissement du medical
Nikkor 200mm, me semble une limite pour le travail
à main levée sur le terrain. Au dela, on entre
dans la macro de labo avec un banc optique stable . Je
propose donc aussi de
séparer
2 domaines de part et d’autre du grandissement de 3x = 12mm
de
champ.
Cela distingue la macro encore possible sur le terrain de la
macro obligatoirement réalisée en labo ou
macro-micro! car elle peut utiliser le microscope composé (
en particulier les modèles épiscopiques ou les
microscopes photographiques de faible grandissement appelés
"macroscopes" ). Il faut noter que la faible profondeur de champ
liée aux grandissements ed super macro, imposent en pratique
la
technique de la zedification dans ce domaine.
Faire commencer le domaine de la microscopie à 1mm de champ n'est pas incohérent avec d'autres définitions basées sur des détails résolus supérieurs à ceux distinguables à l'oeil nu. Mème si selon les techniques employées, la macrophotographie permet déja un peu de visualiser des détails difficilement visibles à l'oeil nu comme des cellules d'organes végétaux ou des grosses diatomées circulaires dans des argiles à diatomées...
Nous
avons eu une
discussion sur le forum "le naturaliste", ou
l'idée que la macro actuelle était souvent la
proxi a été rappellée et
d'autre part les
définitions de Savazzi élargissant le domaine de
la macro
m'ont convaincu de donner un sens large à macro qui englobe
la
proxiphotographie. Mais
je préfère garder la limite classique proxi/macro
au sens strict à 1x donc 36mm de champ.
Je place aussi une
nouvelle catégorie supermacro qui correspond en fait au
dépassement des
possibilités des objectifs encore utilisables sur le terrain
comme un
medical Nikkor 200mm ou un Canon MPE65.
Le tableau suivant est donc proposé pour intègrer la polysémie du terme macro avec son sens grand public, et pour insister sur la limite à 3x qui me semble correspondre au maximum de grandissement possible en général sur le terrain.
 |
Pour terminer, il faut bien reconnaitre que si des définitions précises sont nécessaires pour parler des mèmes choses, en pratique, le macrophotographe (en particulier s'il est naturaliste) ne se limitera pas au domaine de la macrophotographie et illustrera son sujet aussi en photo rapprochée et en photomicrographie!
Voici la palette dans le domaine "macro":
| macro
grand public, close up (proxiphotographie ) (0,6x , Nikon et 105mm microNikkor)  fleur de mauve (Malva sylvestris ) |
macrophotographie
(2x , Canon et MPE-65mm)  détail
pistil et étamines
|
supermacrophotographie
(18x, Sony Nex7, LT Olympus BH2 et objectif Mitutoyo 20X ) 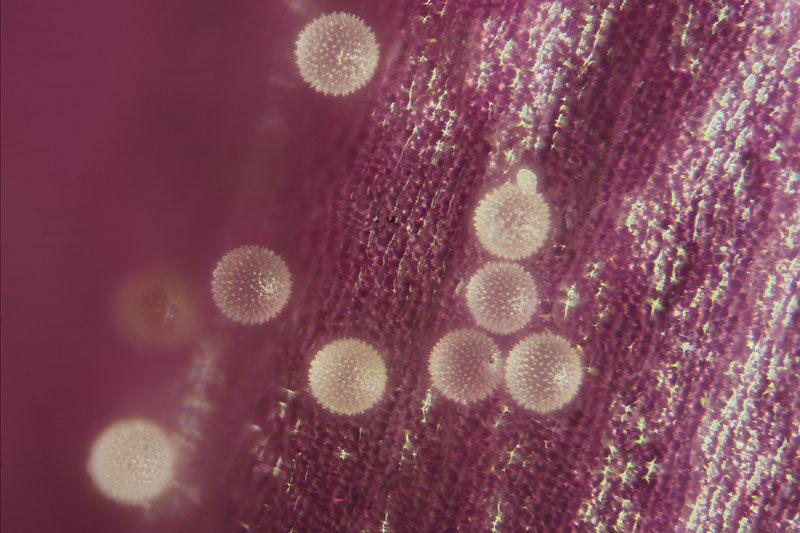 pollen sur
pétale
|
et avec un champ encore plus limité, et l'usage du microscope composé, voici des exemples dans le domaine micro, disputé avec la supermacro...
| Photomicrographie
"classique" (zedifiée toutefois) (50x, objectif Olympus 20x et projectif 2,5x sur BH2) 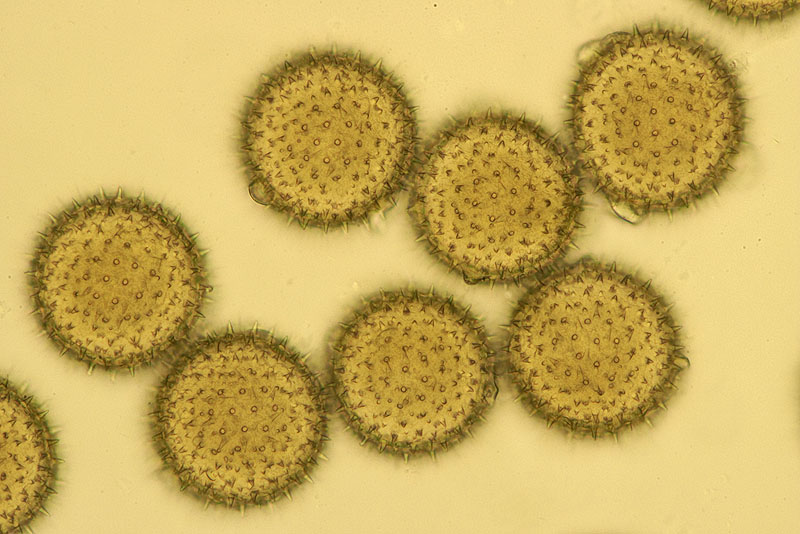 pollen de mauve en diascopie |
Photomicrographie
épiscopique zedifiée (100x,objectif Olympus 40x et projectif 2,5x sur BH2M) 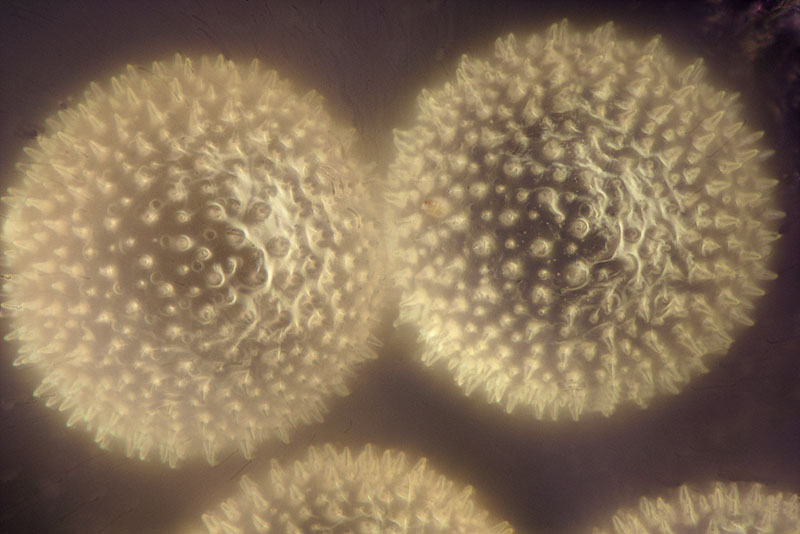 pollen de mauve au microscope épiscopique en fond noir |
Liens :
Ma
bibliographie proxi et macrophotographie